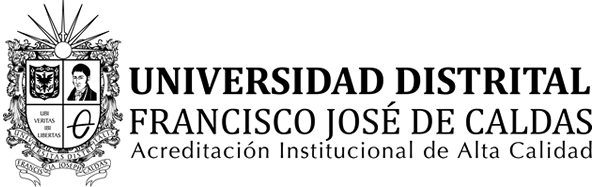DOI:
https://doi.org/10.14483/21450706.13527Publicado:
2018-07-01Número:
Vol. 13 Núm. 24 (2018): julio-diciembreSección:
Sección CentralLa Modernidad estética: una noción para repensar
Palabras clave:
modernidad, estética política, régimen de representación, redistribución de lo sensible (es).Descargas
Cómo citar
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita
La Modernidad estética: una noción para repensar
Calle14: revista de investigación en el campo del arte, vol. 13, núm. 24, 2018
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Resumen:
Repensar la modernidad estética consiste en tratar de identificar un aspecto del tiempo como una forma de compartir lo sensible, más allá de concepciones simplistas de la temporalidad. Se trata de mostrar que hay un elemento esencial que constituye una revolución estética: ya no se construyen obras sino formas de una vida sensible; que existe la idea de una comunidad sensible liberada de cálculos estratégicos. Así, la política inspirada en este regime estético, es una política de indeterminación, de libertad, que da origen a la idea de una política propiamente estética, de un comunismo estético en el que hay comunicación directa entre las formas del arte y de la vida. Esto se muestra, analizando dos afiches de la película El hombre de la cámara (1929) de Dziga Vértov. En consecuencia, la política estética ya no consiste en producir obras, con mensajes específicos que provoquen efectos precisos, sino en construir un tejido, de fondo sensible común y no determinado, que al poner distancia produce espacios de libertad.
Palabras claves
Modernidad, estética política, régimen de representación, redistribución de lo sensible. Esthetic Modernity: a notion to rethink
Palabras clave:Modernidad, estética política, régimen de representación, redistribución de lo sensible.
Abstract:
Rethinking aesthetic modernity consists in trying to identify an aspect of time as a way of sharing the sensible, beyond simplistic conceptions of temporality. The aim is to show that there is an essential element that constitutes an aesthetic revolution—the fact that works are no longer constructed, but instead, forms of a sensible life; that there is the idea of a sensitive community liberated from strategic calculations. Thus, the policy inspired by this aesthetic regime is a policy of indetermination, of freedom, which gives rise to the idea of a properly aesthetic policy, of an aesthetic communism in which there is direct communication between the forms of art and those of life. This is shown by analyzing two posters for the film The Man with the Movie Camera (1929) by Dziga Vertov. Consequently, the aesthetic policy no longer consists in producing works, with specific messages that provoke precise effects, but in constructing a fabric, with a common and undetermined sensitive background, which, when putting distance, produces spaces of freedom.
Keywords:
Modernity, political aesthetics, representation regime, redistribution of the sensible.
Résumé:
Repenser la modernité esthétique consiste à tenter d’identifier un aspect du temps comme un moyen de partager le sensible, au-delà des simplifications de la temporalité. Le but est de montrer qu’il existe un élément essentiel qui constitue une révolution esthétique — le fait que l’on ne construit plus des œuvres mais des formes de vie sensible ; qu’il y a l’idée d’une communauté sensible libérée des calculs stratégiques. Ainsi, la politique inspirée par ce régime esthétique est une politique de l’indétermination, de liberté, ce qui donne lieu à l’idée d’une politique esthétique proprement dit, d’un communisme esthétique dans lequel il existe une communication directe entre les formes d’art et de la vie. Ceci est illustré par l’analyse de deux affiches de la publicité du film L’Homme à la caméra (1929) de Dziga Vertov. Par conséquent, la politiq ue esthétique ne consiste plus à produire des œuvres avec des messages spécifiques qui provoquent des effets précis, mais à construire un tissu avec un fond sensible commun et indéterminé qui, en mettant de la distance, produit des espaces de liberté. Mots clés Modernité, esthétique politique, régime de représentation, redistribution du sensible. Modernidade estética: uma noção para repensar
Mots clés:
Modernité, esthétique politique, régime de représentation, redistribution du sensible.
Palavras chave:
Modernidade, estética política, regime de representação, redistribuição do sensível

Jacques Rancière y Pedro Pablo Gómez en Bogotá.
Fotografía: Ricardo Arcos-Palma.
Pour aborder ma question, je dois d’abord rappeler quelques thèses fondamentales que j’ai formulées notamment dans Le Partage du sensible. « Esthétique
», pour moi, ne désigne pas la philosophie de l’art ou du Beau mais un régime spécifique d’identification de l’art. l’Art n’est pas en effet quelque chose qui existe par soi- même. Même si les histoires de l’art commencent leur récit dans la nuit des temps avec les peintures rupestres, l’Art comme notion désignant une forme d’expérience spécifique n’existe en Occident que depuis la fin du
dix-huitième siècle. Il existait assurément auparavant toutes sortes d’arts, au sens de techniques, de manières de faire. Parmi ceux-ci, certains jouissaient d’un statut privilégié, par exemple les « arts libéraux » ou, plus tard, les « beaux-arts ». Mais l’Art, au singulier et avec un A majuscule, l’Art comme sphère d’expérience spécifique n’existait pas en Occident avant la fin du XVIII° siècle.
Cela veut dire deux choses. Premièrement, l’Art existe seulement à l’intérieur d’un régime d’identification, permettant que des choses très éloignées par leurs techniques e production et leurs destinations soient perçues comme appartenant en commun à un même domaine d’expérience . Il ne s’agit pas de la « récep- tion » des œuvres d’art. Il s’agit du tissu d’expérience sensible au sein duquel elles sont produites. Ce sont des conditions tout à fait matérielles — des lieux de performance et d’exposition, des formes de circulation et de reproduction —, mais aussi des modes de per- ception et des régimes d’émotion, des catégories qui les identifient, des schèmes de pensée qui les classent et les interprètent. Ces conditions rendent possible que des paroles, des formes, des mouvements, des rythmes soient ressentis et pensés comme de l’art.
Voici maintenant le second point : si l’existence d’une chose nommée Art dépend de telles conditions, cela veut dire qu’elle dépend d’un certain partage du sen- sible, en entendant par là un ensemble déterminé de relations entre des modes d’être et des modes de faire. Mais ce système de relations qui distribue les objets et les performances dans des sphères d’expérience spé- cifiques, appelées par exemple « art » ou « politique », est le même qui distribue les êtres humains selon leurs manières d’être et de faire. La visibilité d’une chose nommée art dépend donc d’une certaine distribution des activités humaines, du caractère noble ou vulgaire attribué à ces activités, de la visibilité ou de l’invisibilité de ceux qui la pratiquent. Ainsi la hiérarchie oppo-
sant les arts « libéraux » aux arts « mécaniques » était fondée non pas sur la qualité propre de ces arts mais sur la qualité des personnes dont c’était l’activité ou le
divertissement. L’Art, avec un grand A, a commencé à exister en Occident quand cette hiérarchie a commencé à vaciller. Il a commencé à exister comme la consé- quence d’une redistribution des formes d’action et
de vie et de leur mode de visibilité.
A partir de là il apparaît nécessaire de revoir certaines notions qui ont servi à penser les transformations dans le monde de l’art et leurs implications politiques, comme les notions de « Modernisme », de « modernité
» ou d’« avant-garde ». Ces notions voulaient histori- ciser et politiser les transformations de l’art. Mais s’il apparaît que l’Art est déjà une configuration d’expé- rience historiquement déterminée et que son historicité signifie une redistribution des relations entre les formes de vie et les sphères d’expérience, ces notions doivent être revues sous cet angle et il convient de réexaminer la vision de l’action du temps qui les soutient.
Il me semble en effet que les notions usuelles de modernité et d’avant-garde reposent sur une vision simpliste de la temporalité. Pensons par exemple à l’analyse de Clement Greenberg dans « Avant-Garde et Kitsch ». Cette analyse suit la vision de la modernité
forgée au temps de la Contre- Révolution et du roman- tisme : la modernité comme processus d’accélération provoquant la rupture de la tradition. D’un côté, nous explique-t-il, cette accélération détruit le tissu de croyances et de valeurs partagées qui liait la pratique des artistes, le contenu de leurs œuvres et les attentes de leur public. En ce sens, elle rend l’art orphelin. Mais, de l’autre, elle fait peser sur lui une pression fatale.
L’industrialisation massive qui pousse les masses rurales vers les villes crée ainsi des populations sépa- rées de leur culture traditionnelle mais aussi privées, dit Greenberg, « du loisir et du confort nécessaires pour jouir de la culture urbaine traditionnelle ». Ces masses « font pression sur la société pour qu’elle leur procure une forme de culture faite pour leur consom- mation propre ». Or la même industrie qui a créé cette demande fournit aussi la réponse en développant des formes de musique ou des magazines populaires dont le succès est pour les artistes à la fois une concurrence déloyale et une tentation fatale.
Ainsi, dans cette analyse, la question du temps est ramenée à l’action de cette accélération industrielle qui crée une scission entre deux formes d’activité : l’une qui produit des objets destinés à la consommation populaire accélérée et notamment une « industrie culturelle » ; et une autre qui n’a plus de destination sociale et doit par conséquent se replier sur soi et devenir une fin en soi.
En un sens l’autonomisation du grand art n’est qu’un effet de ce processus d’accélération. Le « grand art » n’a pas d’autre choix que de se projeter toujours en avant en ne s’occupant que de lui-même. Mais cette marche forcée reproduit en même temps l’opposition entre ceux qui marchent devant, en avance sur leur temps, et ceux qui traînent derrière : ces fils et filles de paysans qui goûtent, aux Etats-Unis, la musique de Tin Pan Alley, et en Russie les peintures du réalisme soviétique. Il n’est pas indifférent que l’art commandé par l’Etat stalinien soit analysé par Greenberg comme manifestation de
la culture kitsch. Ce raccourci, qui fait peser toute la faute sur les fils et filles de paysans, lui permet d’oublier ce qu’a été, dans les années 1920 en Russie, le projet moderniste d’union entre les formes de l’art et de la
vie afin de poser un dilemme simple : ou bien la pureté moderniste du « grand art » ou bien la culture kitsch. Pour le faire, il doit ramener la question du temps aux simples oppositions entre le rapide et le lent et entre l’avancé et l’arriéré. C’est-à-dire qu’il s’en tient au temps comme mesure quantitative, alors que ce qui est en jeu, c’est la « qualité » du temps, cette qualité qui est en jeu dans la question de la capacité ou de l’incapacité des fils et filles de paysans à savoir jouir du loisir. Mais s’il peut le faire, c’est peut-être que ceux qu’il cherche à enterrer n’avaient eux-mêmes pas réussi à distinguer le temps, comme forme de partage du sensible, du temps comme simple affaire de vitesse ou de lenteur, de nouveauté ou d’ancienneté. Repenser la modernité esthétique voudra alors dire pour moi essayer de dégager cet aspect du temps comme forme du partage du sensible, de voir le rôle qu’il a joué dans le projet moderniste, les tensions qui le caractérisent et qui ont conduit à cette vision
simpliste qui gouverne encore la discussion sur le moder- nisme et le postmodernisme.
Pour mener cette enquête, je me concentrerai sur un exemple caractéristique où l’on peut voir condensées les formes de redistribution du sensible en jeu sous les mots de modernité et d’avant- garde. Voici deux affiches dessinées en 1928 par deux artistes sovié- tiques, les frères Stenberg pour un film emblématique,
L’Homme à la caméra de Dziga Vertov. Dans la distribu- tion des mots et des formes, des corps et des espaces, nous percevons d’emblée que ces posters font plus que de la publicité pour un film. Ils dessinent bien plus tôt les coordonnées du monde sensible nouveau auquel ce film prétend appartenir : le monde de l’homme en mou- vement avec les machines. Ce monde nouveau se signi- fie d’abord ici par la distance de la figuration ici adoptée par rapport à la façon dont sont normalement évoqués les personnages et l’atmosphère d’un film. Les deux
affiches nous montrent un corps féminin. Mais celui ne joue pas le rôle habituel de l’objet du désir. Et ce n’est pas davantage un personnage manifestant les signes d’un sentiment identifiable. C’est seulement un corps en acte, un corps performant — même si, on y reviendra, il doit se scinder en deux parties pour accomplir ses deux performances — se mouvoir et voir — , lesquelles sont exactement les mêmes que celles de la machine. Les affiches couplent son œil avec celui de la caméra et la courbe de ses jambes avec celle du caméraman pen- ché sur son appareil. L’image nous dit clairement : ce film appartient à un temps nouveau. Il ne raconte pas d’histoire ; il ne présente pas d’acteurs incarnant des personnages et nous invitant à partager leurs émotions. Il n’y a plus là de représentation. Il y a seulement une performance d’art directe et ce que montre l’affiche,
ce sont les éléments — humains et mécaniques — qui composent cette performance.
Cette opposition pourrait d’abord sembler valider l’idée de la modernité artistique résumée par Clement Greenberg : la modernité comme congé donné à la
représentation et concentration de l’art sur l’exploration des ressources de son médium propre. Mais, en fait, bien loin de confirmer la thèse, l’affiche et le film — dont
je parlerai plus tard — changent la notion même de médium. Ils en font non plus le matériau ou le support d’une pratique spécifique mais un sensorium global où des pratiques différentes se fondent. L’idée de la «
modernité » comme spécificité du médium s’appuie sur la distinction faite par Lessing entre art des mots et art des formes plastiques, art du temps et art de l’espace. Or c’est cette distinction qui est ici abruptement déniée. L’affiche construit un sensorium où un assemblage de mots et un déploiement de formes visuelles sont des manifestations du même mouvement. Sur la seconde affiche, notamment, les parties du corps et les lettres indiquant les noms du cinéaste, du cameraman et de la monteuse sont combinées dans une spirale qui suggère à la fois l’objectif d’une caméra et l’hélice d’un avion en vol. Les mots, les formes visuelles et les mouvements sont emportés dans une seule réalité dynamique. Sur la surface de l’affiche, tout est en mouvement et tous les mouvements sont homogènes.
Cette convergence entre l’art des mots, l’art des formes et celui du mouvement, il y a longtemps déjà qu’il était au cœur des tentatives de nouveauté artistique. Dans les années 1890, des poètes comme Mallarmé trou- vaient le modèle d’une écriture nouvelle dans la danse de Loïe Fuller, une danse conçue non plus comme l’illustration d’une histoire mais comme un déploiement

Hermanos Stenberg
Hermanos Stenberg, afiche de la película El Hombre de la cámara de Dziga Vertov. (1929).

Hermanos Stenberg
Hermanos Stenberg, afiche de la película El Hombre de la cámara de Dziga Vertov. (1929).
de formes dans l’espace. Les inventeurs de la mise en scène théâtrale ont, à leur tour, rêvé d’un art du théâtre où les mots ne seraient plus, selon le mot de Meyerhold, que « des dessins sur la trame du mouvement » ; puis les peintres cubistes ont mis , avec Braque et Picasso, les manchettes des journaux sur leurs toiles avant que les peintres futuristes, avec Boccioni ou Severini, ne brisent la surface de la toile en mille facettes pour lui faire exprimer le dynamisme de la vie moderne ou celui des bals populaires. Mais les artistes soviétiques sont évidemment les mieux placés pour nous montrer ce qui est en jeu dans cette fusion des mots et des formes dans le dynamisme du mouvement : ce qui y est en jeu, c’est la fusion des formes de l’art et de celles de la vie nouvelle :c’est là une révolution esthétique qui se pense comme immédiatement politique parce qu’elle met ensemble ces formes d’activité et de vie que la vieille société tenait séparées, en somme, parce qu’elle opère, selon mes termes, un repartage du sensible.
Reste à savoir comment l’on peut caractériser cette révolution. Il y a une réponse à la question qui est bien connue. C’est celle qui dit que désormais les assem- blages de mots, de formes ou de mouvements ne sont plus un spectacle offert à la contemplation de spec- tateurs passifs. Ils sont devenus des actions. Et cette transformation est tout particulièrement sensible là où, comme dans la Russie soviétique, l’action productive, celle des hommes travaillant avec les machines a été reconnue comme le cœur même de la vie collective. « Tout est mouvement » serait alors synonyme de « Tout est action ». Ces affiches pourtant donnent à cette action une étrange figure. Cette action est celle de corps qui sont des ombres, comme le caméraman, ou bien des corps fragmentés, devenus semblables aux rouages d’une machine dans le cas de la danseuse. Il semble alors que le problème ne soit pas simplement d’opposer une performance directe des corps aux vieilles histoires d’amour et de haine. Il est de détruire le modèle organique qui soutenait aussi bien la concep- tion représentative de l’action que le modèle représen- tatif de la beauté visuelle.
Le point fondamental est en effet que l’ordre représen- tatif n’était pas normé par la notion d’imitation mais par la notion qui servait, depuis Aristote, à normer et
à légitimer l’imitation artistique, à savoir précisément l’action. La poésie, dit Aristote, n’est pas définie par le vers. Elle est définie par l’action, qui est un assemblage d’événements unis par la nécessité ou la vraisemblance. Et le même Aristote oppose cette connexion causale, définissant l’action poétique comme un tout, à la simple
succession des faits, arrivant l’un après l’autre. Ce modèle poétique de l’action comme formatrice du tout, la tradition représentative en a fait une norme générale de l’art : une peinture, une sculpture ou un ballet étaient des œuvres d’art si leurs combinaisons de formes ou de mouvements pouvaient être considérées comme des représentations d’actions. Réciproquement le modèle narratif de l’action était gouverné par le modèle visuel du corps vivant, avec ses membres bien articulés sous le commandement de sa tête. Mais ce modèle organique se liait lui-même au privilège d’une certaine forme de vie. L’action n’était pas seulement une connexion d’évé- nements, c’était aussi la forme de vie d’une certaine catégorie d’humains. C’était la catégorie organisatrice d’un partage du sensible opposant deux manières d’être et deux classes d’humains : d’un côté, les hommes dits actifs, ceux qui sont également capables de concevoir et de poursuivre de grandes fins ou d’agir pour le seul plaisir d’agir ; de l’autre, les hommes dits passifs, non parce qu’ils ne font rien, mais parce qu’ils étaient enfer- més dans le cercle de la vie reproductive où l’on n’agit que pour les besoins immédiats de cette reproduction. On les appelait aussi « hommes mécaniques », hommes enfermés dans la sphère des moyens destinés à des fins utilitaires. En face, les hommes d’action s’appelaient aussi hommes de loisir, parce que le temps libre était l’étoffe même de leur activité, alors qu’il ne pouvait être, pour les « mécaniques » que la détente séparant deux temps de travail. Seuls les hommes d’action et de loisir pouvaient fournir les modèles du corps harmonieux et seule leur forme de vie se prêtait à la perfection des intrigues narratives.
Tel est le partage des temps qui structurait la logique représentative. Il ne s’agit pas de lenteur ou de vitesse, d’avance ou de retard mais de séparation entre des formes de vie. Les hommes d’action — et de loisir — qui fournissaient à la perfection artistique ses modèles ne vivaient pas dans le même temps que les hommes mécaniques. C’est pourquoi, pour en revenir à mon exemple, la destruction de l’intrigue représentative ne peut se réduire pas à opposer la performance directe
à la distance représentative. Ce qui est en jeu, c’est la destruction du modèle organique de l’action et du partage du sensible dont il faisait partie. C’est aussi
pourquoi le devenir-politique de l’art ne peut s’identifier simplement à son devenir-actif, avec la transformation du spectacle en action. L’opposition de l’action à la « passivité » du spectacle reste enfermée dans le modèle représentatif. Seule la rupture même de l’opposition rompt avec lui. Et c’est ce que procure ici l’union de l’œil et du mouvement qui s’opposent à l’action et
au corps organique. Si le mouvement est le médium au sein duquel les mots et les formes viennent se confondre, ce n’est pas parce qu’il signifie l’énergie de l’action. C’est au contraire parce qu’il signifie la des-
truction du modèle classique de l’action. Le mouvement de la danseuse offre un paradigme esthétique et poli- tique du dynamisme nouveau parce qu’il est un corps non-organique, doté par sa fragmentation d’un double pouvoir. C’est un corps fonctionnel tout entier voué à sa performance et c’est l’expression d’une puissance supérieure à celle de l’organisme : la vie, le principe de tout ce qui se meut qui dissout le privilège de l’action dans l’égalité du mouvement.
C’est aussi le point où intervient la machine. La fusion du corps et de la machine sur les affiches et plus large- ment le rôle de la machine dans l’art dit d’avant-garde a souvent été réduite à cette admiration naïve pour la nouveauté technique, la vitesse et l’efficacité que l’on trouve dans le Manifeste futuriste de Marinetti. On voit ici que ce qui y est en jeu est bien plus radical : il s’agit proprement de la destruction du modèle organique.
La machine est bien plus que le pouvoir de la tech- nique efficace. C’est l’abolition de l’opposition entre les hommes actifs et les hommes mécaniques. La machine ne connaît pas l’opposition entre activité et passivité. Les mouvements conjugués de la danseuse et de la machine marquent en fait la ruine du partage hiérar- chique du sensible.
Bien sûr cette destruction n’est elle-même que figurée et sa figuration ne se fait pas sans quelques étran- getés. Ainsi l’espace à damiers sur lequel la danseuse danse se trouve-t-il transformé en un gratte-ciel, en sorte que la danse ressemble à un envol ou bien à une chute vue dans une perspective renversée. Le sol et
le ciel, le bas et le haut semblent se confondre, annu- lant la profondeur de la scène sur laquelle les danseurs exécutent ordinairement leurs figures, pour construire à sa place un espace symbolique. Cet espace symbo- lique veut être un espace américain, tel du moins qu’on l’imagine alors en Europe, un espace qui n’est qu’une
symphonie de gratte-ciels. Corrélativement la danseuse, avec ses hauts talons et ses cheveux courts, ressemble plus à une femme libre à l’américaine qu’à une tra- vailleuse soviétique de choc. Mais la perspective dans laquelle les gratte-ciels et la danseuse sont emportés est elle- même désaxée, entraînée par la loi de cette ligne oblique qui a obsédé les artistes soviétiques de
ce temps et que El Lissitzky a théorisée comme la ligne génératrice du nouveau monde, succédant à la verticale gothique et à la sphère classique. Cette ligne a deux
grandes propriétés. D’abord elle construit un espace égalitaire, abolissant la hiérarchie du haut et du bas. Mais aussi elle construit un espace infini. C’est dans le temps que se projette en fait la danseuse — hélice. Mais ce temps est lui-même d’une espèce particulière : c’est un temps comme en avance sur lui-même. Et cet espace temporalisé, construit par la ligne oblique, communique à la danseuse ses propriétés. Elle aussi est comme en dehors d’elle-même, en avance sur elle-même. Elle est
à la fois le corps fragmenté de l’industrie taylorisée et l’impulsion holistique de la vie. Ou plutôt elle est à la fois l’unité des deux et leur disjonction.
On voit bien alors ce qui donne à cette figuration son étrangeté. Les affiches essaient de fondre trois choses en une : la modernité artistique comme anti-représen- tation, l’élan unanimiste de la vie moderne et la révo- lution communiste. Cette identification justement ne peut être directe, il faut la symboliser. Et on ne peut
la symboliser que comme le mouvement d’un corps séparé de lui-même dans un espace impossible. Cette torsion n’a pour moi rien d’accidentel. Elle n’est pas liée aux difficultés spécifiques d’adéquation entre un programme esthétique moderniste et un programme politique communiste. Elle engage la révolution esthé- tique comme telle, j’entends par là cette destruction du modèle représentatif de l’action au profit des paradigmes nouveaux du mouvement et de la vie. Elle engage la politique propre à cette révolution. Le pro- jet d’un art nouveau, suivant le mouvement de la vie nouvelle, révèle une tension qui a été dès l’origine au cœur de la révolution esthétique et des paradoxes de sa politique.
Pour le montrer un petit détour historique est néces- saire. Ce détour nous ramènera dans ces années 1760 où le modèle représentatif se voit mis en question de diverses façons. Dans ces années notamment le modèle classique de l’action dramatique subit deux grands types de critique que deux livres peuvent résumer : les Entretiens sur le Fils Naturel de Diderot et La Lettre
à D’Alembert de Rousseau. Diderot mettait en cause deux aspects de la convention théâtrale : à l’habileté artificielle des intrigues avec leurs coups de théâtre, il opposait la réalité des situations telles qu’elles se
présentent dans la vie courante. Et, aux conventions du langage noble, il opposait la multiplicité des tons, des cris étouffés, des interruptions, des silences, des gestes et des attitudes qui, dans la vie réelle, traduisent la vérité des sentiments et l’intensité des émotions, avec toutes leurs variations imperceptibles. Il proposait donc de substituer à la convention de l’action un langage de
signes corporels. Le maître mot de cette critique était celui d’expression.
Quelques années plus tard, la Lettre sur les spectacles de Rousseau mettait en cause les effets supposés de l’action théâtrale. En dépit de ses prétentions, disait Rousseau, le théâtre n’enseigne rien. Le seul sentiment réel qu’il produise chez le spectateur, c’est l’amour du théâtre, l’amour pour ses ombres et pour cette ombre de bonheur au profit de laquelle on renonce à la pour- suite du bonheur dans la vie réelle. Aux fausses leçons de moralité du théâtre il opposait l’énergie collective donnée aux citoyens de Sparte par leurs chants et leurs danses ou le sens de la communauté fraternelle produit par les fêtes populaires suisses.
L’un et l’autre donc mettaient le modèle représentatif en cause au nom de la vie et du mouvement. Et l’on sait que leurs critiques et leurs propositions ont eu une longue postérité dans les tentatives pour imposer au théâtre un langage du corps ou pour révoquer le spec- tacle au profit de l’action. Tous deux pourtant restaient à l’intérieur d’une logique mimétique. Ce qu’ils oppo- saient à l’ordre de la mimesis, c’était en fait une forme d’hyper-mimesis. Le langage du corps que proposait
Diderot était un langage de signes entièrement motivés, radicalisant le principe mimétique de correspondance entre les passions et leurs signes. Et en proposant de remplacer le théâtre par la fête, Rousseau reprenait l’opposition platonicienne entre le mensonge théâtral et l’authenticité de la performance chorégraphique où les gestes des citoyens « imitent » le principe même de leur vertu collective.
Aucune de ces deux formes d’ « expression de la vie
» ne pouvait ainsi mettre à bas le vieux privilège de l’
« action ». Ce qui pouvait le briser, c’est une forme de mouvement abolissant en même temps la séparation hiérarchique entre action et passivité et la séparation hiérarchique entre le loisir et la détente. Aussi étrange que cela puisse paraître, il fallait que la « vie expressive
» fût mordue par des pouvoirs d’inexpressivité, que son mouvement soit mordu par une puissance d’immobilité. C’est cela que nous pouvons voir dans la performance de la danseuse sur l’affiche. Mais il est intéressant d’étu- dier la généalogie de cette performance, car elle nous réserve quelques surprises qui jettent une lumière neuve sur la place du mouvement dans le paradigme moder- niste. Dans le même temps où Diderot et Rousseau opposaient la vie expressive aux artifices de l’action théâtrale, Winckelmann publiait son Histoire de l’art dans l’antiquité, le premier livre peut-être qui fasse exister
l’Art au singulier en lui donnant une histoire. Dans ce livre figure notamment la paradoxale analyse de la sta- tue connue comme le Torse du Belvédère : la statue d’un Hercule privé des bras et des jambes nécessaires à ses Travaux. Cet Hercule, dit-il, médite sur ses Travaux pas- sés, mais, comme il n’a pas non plus de tête, sa médita- tion est seulement exprimée par la courbe du dos et les muscles du torse dont les formes passent les unes dans les autres, en un mouvement continu semblable à celui des vagues qui, incessamment, s’élèvent et retombent.
Ce mouvement incessant de muscles semblables à des vagues implique en fait une nouvelle idée du mouve- ment qui neutralise l’opposition même du mouvement et du repos. Cette identité du mouvement et du repos, la postérité lui a donné un nom : le libre mouvement, un mouvement qui n’est pas asservi à la nécessité d’exécuter des actions ou d’exprimer des sentiments. Cela implique une idée nouvelle du corps, de la vie qui le traverse et du mouvement par lequel elle s’exprime.
C’est justement cette idée que les rénovateurs et les rénovatrices de la danse au XX° siècle se sont appliqués à faire revivre à partir de l’observation des peintures de vases grecques ou des frises antiques. La vie du corps n’est plus celle de l’organisme où les membres se coor- donnent pour obéir à une tête. Ce n’est pas non plus
le langage du corps expressif traduisant les émotions en attitudes. Le mouvement libre est un mouvement sans fin, au deux sens du mot : un mouvement qui n’a ni commencement ni arrêt, mais aussi un mouvement dépourvu de finalité. Par cette absence de fin, les ondulations en formes de vagues du Torse incarnent mieux la liberté grecque que les parades des éphèbes spartiates. Par là aussi il se prête à la révolution qui va autonomiser le mouvement. Celui-ci, dans le modèle organique est l’activité en elle-même sans fin qui sert les fins de l’action. Il est, en quelque sorte, l’inaction logée au cœur de l’action et qui sert l’action. Mais cette inaction peut être autonomisé indépendamment de l’action, voire contre elle.
C’est cette émancipation de la puissance d’inaction interne aux moyens de l’action que Schiller a résumée, trente ans après la publication du livre de Winckelmann. Ce qu’il a appelé la pulsion de jeu, c’est l’équivalence de l’action et de l’inaction. La pulsion de jeu est plus qu’un type de mouvement, c’est une forme d’expérience,
la forme dans laquelle le sujet n’est plus déterminé, comme il l’est dans l’expérience sensible ordinaire, à mettre en œuvre une capacité spécifique pour répondre à un besoin, un intérêt ou une impulsion. La liberté esthétique, ou le jeu, est l’expérience d’une capacité
d’indétermination qui est une expérience d’humanité comme telle, l’expérience d’une capacité partageable par tous, congédiant les oppositions qui structuraient à la fois l’action et l’inaction. Ce qui brille sur la figure de la déesse, dit Schiller, est l’oisiveté, l’absence de
tout souci et de toute volonté. Mais ces propriétés de la déesse sont en fait celles du peuple qui a commandé la statue. La liberté esthétique est une liberté par rapport aux enchaînements de fins et de moyens propres à la liberté. C’est en ce sens qu’elle fonde à la fois une nou- velle idée de l’art mais aussi une nouvelle idée de l’art de vivre individuel et collectif.
Nous pouvons maintenant revenir à nos affiches. La per- formance de ce corps scindé dans un espace — temps mis hors de lui-même exprime une configuration de l’es- pace et du temps où l’activité constructive des hommes et des femmes est identique à l’indifférence du mou- vement libre et à l’inaction du jeu exprimant la liberté collective. Cette union de l’ « indifférence » divine avec la construction du nouveau monde communiste peut sembler paradoxale. On peut dire que c’est là une vision toute « esthétique » du communisme. Pour ceux qui, au temps de Vertov et des frères Stenberg dirigent le Parti Communiste et l’Union soviétique, le communisme est en effet tout autre chose qu’une danse sans fin ni but. Il est la forme de vie collective qui résultera du succès des plans d’industrialisation et de collectivisation, au prix du
travail et de la discipline. En bref, c’est une affaire de fins et de moyens. Mais l’inverse est aussi vrai. Avant d’être un but à atteindre, le communisme est une idée esthé- tique : l’idée d’une forme d’expérience sensible où juste- ment les moyens et les fins ne se séparent plus. C’était bien ainsi que le jeune Marx l’avait présenté : comme une forme de vie où l’activité productrice où s’exprime l’es- sence générique de l’homme n’était plus un moyen mais une fin en soi. C’était, clairement, une idée héritée de Schiller et de ses interprètes romantiques : l’idée d’une forme de communauté où l’idéalité de l’essence humaine n’est plus séparée de la vie concrète des individus. Aussi longtemps que le communisme est un but à atteindre par un ajustement calculé des moyens aux fins, il demeure à l’intérieur de la vieille logique représentative. Pour en sor- tir, il doit exister déjà, en avance sur lui-même, comme une forme déjà présente d’expérience sensible.
Une telle anticipation définit une présence du futur dans le présent qui est assez éloignée de ce qu’on entend habituellement sous le nom d’« avant-garde ». Il ne s’agit pas d’être avance sur son temps ou en avance sur la foule attardée. Il s’agit de mettre deux temporalités en une seule : une temporalité des moyens et des fins
et une temporalité où elles sont devenues indistinctes. C’est déjà ainsi que l’on peut comprendre le grand projet du jeune Marx : unir le cœur français à la tête allemande, la temporalité française de l’action et une temporalité allemande où l’action a incorporé le moment de l’inaction.
C’est que la modernité, telle qu’il la conçoit, n’est pas l’accélération du temps. C’est le temps d’une disjonc- tion de temporalités. Mais, cette disjonction, c’est peut- être un autre que lui , un autre disciple de l’idéalisme allemand, qui l’a exprimé de l’autre côté de l’Atlantique. Je pense à Emerson et à cette conférence sur « Le Poète » qui est contemporaine des premiers écrits de Marx. Comme Marx, Emerson affirme que ce que dont l’humanité moderne a besoin, pour la rédemption de ses péchés, est une nouvelle confession. C’est là, dit-il, l’œuvre du poète à venir. Celui-ci devra trouver « dans la barbarie et le matérialisme du temps, une autre ronde des mêmes dieux qu’il admire si fort chez Homère ». Il devra donner aux étalages d’objets prosaïques et aux opérations de la vie prosaïque leur valeur de symboles de la vie commune. Je pense qu’en définissant ainsi la tâche du poète à venir, Emerson a peut-être formulé de la manière la plus exacte ce que modernité et moder- nisme peuvent vouloir dire. La tâche qu’il confiait à son poète est exactement celle que les artistes dits d’avant- garde se sont donnée comme objectif : la construction d’un sensorium au sein duquel les vieilles divisions hié- rarchiques qui structuraient l’expérience commune sont déjà abolies , dans lequel toutes les activités expriment le même esprit de communauté — un esprit présent
de la même façon dans le travail des machines utiles ou dans la joyeuse vitalité d’une femme qui danse, un esprit qui lie tout à tout en un mouvement sans fin.
C’est un tel mouvement et un tel rapport de chaque chose au tout que le film lui-même de Dziga Vertov, L’Homme à la caméra, manifeste. Le film ne raconte pas d’histoires. Il met seulement en rapport des activi- tés, ces activités qui s’exécutent tous les jours dans les rues, les magasins, les usines, les bureaux, les stades ou les clubs ouvriers. Mais il ne s’agit pas de représenter ces actions. Il s’agit d’une activité qui relie toutes ces activités et les organise en une « chose-film » qui est elle-même un élément de la vie nouvelle. En ce sens le montage exécute la tâche du poète emersonien : tisser le fil spirituel qui lie toutes les activités en un seul tout sans hiérarchie. On se souvient que le premier poète à se conformer au programme d’Emerson, Walt Whitman avait tissé entre toutes les activités — si prosaïques fussent-elles le plus immatériel des liens : ces points de
suspension qui donnent à la première édition des Leaves of Grass son aspect si singulier. Le montage vertovien fonctionne à la manière de ces points de suspension pour tisser le lien spirituel qui est l’âme commune de toutes ces activités. Son opération principale consiste
à rendre toute ces activités égales. Cela implique trois choses : premièrement, accorder à toutes la même importance ; deuxièmement, les fragmenter en mor- ceaux extrêmement courts ; enfin, les monter en un temps accéléré, ce temps « en-avance sur lui-même » qui emportait la danseuse/avion au milieu des gratte- ciels. La machine de l’opérateur et celle de la monteuse font de ces activités fragmentées l’expression d’une nouvelle vie collective caractérisée par la connexion instantanée de tous les mouvements. Mais ils le font
au prix de déployer, dans le montage de ces activités la même tension que laissait déjà voir la surface immobile de l’affiche.
Cela peut être vu dans un fragment du film de Vertov, où nous voyons la scission de la danseuse vitaliste/ mécanique réapparaît ici dans la dualité de la cliente élégante du salon de coiffure et de l’ouvrière de l’usine de cigarettes. Le montage semble d’abord opposer l’oisiveté d’une « nepwoman » occupée de sa beauté
à l’activité des travailleuses soviétiques. Mais, à sup- poser que c’ait été l’intention du cinéaste, la pratique même du montage viendrait par elle-même réfuter cette intention. Le montage ne relie pas le sourire de la cliente du salon de coiffure à un statut social. Il le relie à la diligence des mains de la coiffeuse et de la
manucure et à une multiplicité d’autres manifestation de vitalité, depuis la rapidité des gestes des ouvrières à la chaîne jusqu’à leur conversation enjouée. Ce que nous présente cet épisode, c’est en fait un échantillon d’un projet jamais réalisé par Vertov : un film sur les mains, composé de cent-vingt-sept gestes différents. C’est dans cet esprit que nous sont montrés ici aussi bien le travail de la manucure que l’emballage des cigarettes à la chaîne, le coup de chiffon du cireur de chaussures,
le coup de pic du mineur et un grand nombre d’autres gestes, incluant celui du cameraman tournant la mani- velle et celui de la monteuse, coupant, rangeant et collant les fragments. Tous ces gestes sont des mani- festations équivalentes de la même énergie collective. Leur connexion généralisée compose un tissu de la vie commune où tout est mouvement. Mais nous reconnais- sons la nature de ce mouvement : c’est le mouvement libre, le mouvement sans fin de la vague qui retombe sur la vague. La condition de cette connexion ininterrom- pue, c’est que chacune de ces activités soit déconnec- tée de sa temporalité propre et des fins qu’elle poursuit.
Les détracteurs de Vertov avaient déjà dénoncé cette réduction dans ses films antérieurs : ses machines composaient peut-être une grandiose symphonie du mouvement, mais il était impossible de savoir comment elles fonctionnaient et ce qu’elles produisaient. C’est qu’en effet Vertov ne « représente » pas le communisme comme le résultat d’une organisation planifiée et d’une hiérarchie de tâches. Il crée le communisme comme rythme commun de toutes ces activités. Mais ce rythme commun suppose qu’elles partagent toutes la même caractéristique : l’absence de fins. Cette propriété commune rend le travail productif identique au libre jeu schillérien. Mais cette identité ne se manifeste elle- même que dans l’espace du jeu. C’est ce que je voudrais illustrer par ces extraits de la fin du film où nous retrou- vons la danseuse et le trépied de l’affiche dans la salle où les « acteurs » du jour sont conviés à devenir leurs propres spectateurs.
Nous voyons dans cette séquence deux performances opposées de la machine — qui sont aussi deux méta- phores de l’activité cinématographique : il y a la perfor- mance des employées dans le central téléphonique qui sans cesse changent leurs fiches pour permettre des connexions nouvelles. C’est la métaphore de l’action filmique comme connexion de toutes les activités.
Mais, auparavant, nous avons vu la condition de cette connexion généralisée. C’est que toutes les actions soient scindées en fragments apparaissant et dispa- raissant à la même vitesse accélérée. Aussi la caméra et le trépied viennent-ils nous proposer une tout autre image de l’action du cinéaste, en apparaissant comme des automates qui viennent saluer l’audience avant de faire la démonstration de leurs tours de magie. D’un côté le cinéaste est l’employée du central téléphonique qui connecte chaque activité avec toutes les autres. De l’autre, il est le magicien qui les transforme toutes en tours de prestidigitation. Cette coïncidence du travail et
du jeu est montrée elle-même dans un espace consacré au jeu : ce cinéma où les spectateurs se reconnaissent sur l’écran et rient au spectacle de l’accélération fréné- tique de leurs activités quotidiennes, ce qui veut dire, en définitive, qu’ils jouent avec l’idée que ces activités sont la réalisation du communisme et qu’ils construisent le communisme.
Bien sûr les constructeurs du communisme « réel » n’ai- mèrent aucune des deux métaphores. Et ils élevèrent contre le cinéaste deux accusations : les uns dénon- çaient son « panthéisme » ou son « whitmanisme »,
par quoi ils entendaient la fascination pour le flot sans fin de la réalité comme elle est ; d’autres dénonçaient
son formalisme, son indifférence au contenu et son attention au seul montage. Mais les deux accusations revenaient au même. Le « libre mouvement » panthéiste et le libre jeu « formaliste » ont ceci en commun qu’ils rendent équivalents la fin et l’absence de fin, l’activité volontaire et le refus de vouloir. Mais en fait il ne s’agit pas là des errements d’un cinéaste particulier. Cette équivalence est au cœur de la révolution esthétique et de ses deux enfants : la modernité artistique et le com- munisme. Un film qui révélait cette parenté ne pouvait évidemment plaire aux constructeurs du communisme
« réel », celui des moyens bien ajustés aux fins de l’égalité future. C’est pourquoi les officiels de la culture soviétique décidèrent qu’il était temps d’expliquer aux artistes qu’ils n’avaient pas pour tâche de tisser le tissu sensible du communisme. Il ne pouvait y avoir qu’une seule temporalité, celle des moyens et des fins qui était aussi celle du travail et du repos. Ce que les artistes avaient à faire étaient de montrer les efforts et les problèmes des travailleurs et de les distraire après les peines du travail. On leur demandait ainsi de revenir à
la logique représentative en donnant à un public défini la combinaison de plaisir et d’éducation qui était bonne pour lui. Mais cette affaire ne concerne pas seulement les rapports des artistes soviétiques et de leur gou- vernement. Elle concerne le sens même de ce qu’on peut appeler modernisme esthétique. En un sens, c’est bien la fin de son temps que proclamait la répres-
sion soviétique ; c’était, plus largement, la fin d’une modernité qui donnait à l’art la tâche de construire les formes d’une nouvelle vie commune. Cette répression du communisme esthétique par l’Etat stalinien ouvrait la voie à l’opération que je rappelais en commençant : l’opération de ces intellectuels marxistes qui en profi- tèrent pour effacer les traits du modernisme historique pour inventer ce modernisme rétrospectif, identifiant la modernité à l’autonomisation du « grand art », se détournant de la l’industrie culturelle et de la propa-
gande politique pour se consacrer à la seule exploration des possibilités de son medium. Il est peut-être temps aujourd’hui de repenser cette histoire.
Licencia
Licencia actual vigente
Creative Commons BY NC SA - Atribución – No comercial – Compartir igual. Vigente a partir del Vol. 17 No. 32: (julio-diciembre) de 2022.
This work is licensed under a https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
Licencias anteriores
- Desde el Vol. 14 Núm. 25 (2019) hasta el Vol. 17 Núm. 31: enero-junio de 2022 se utilizó la licencia Creative Commons BY NC ND https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
- Desde el Vol 1 Num 1 (2007) hasta el Vol. 13 Núm. 23 (2018) la licencia fue Creative Commons fue Reconocimiento- Nocomercial-Sin obras derivadas 2.5 Colombia https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/